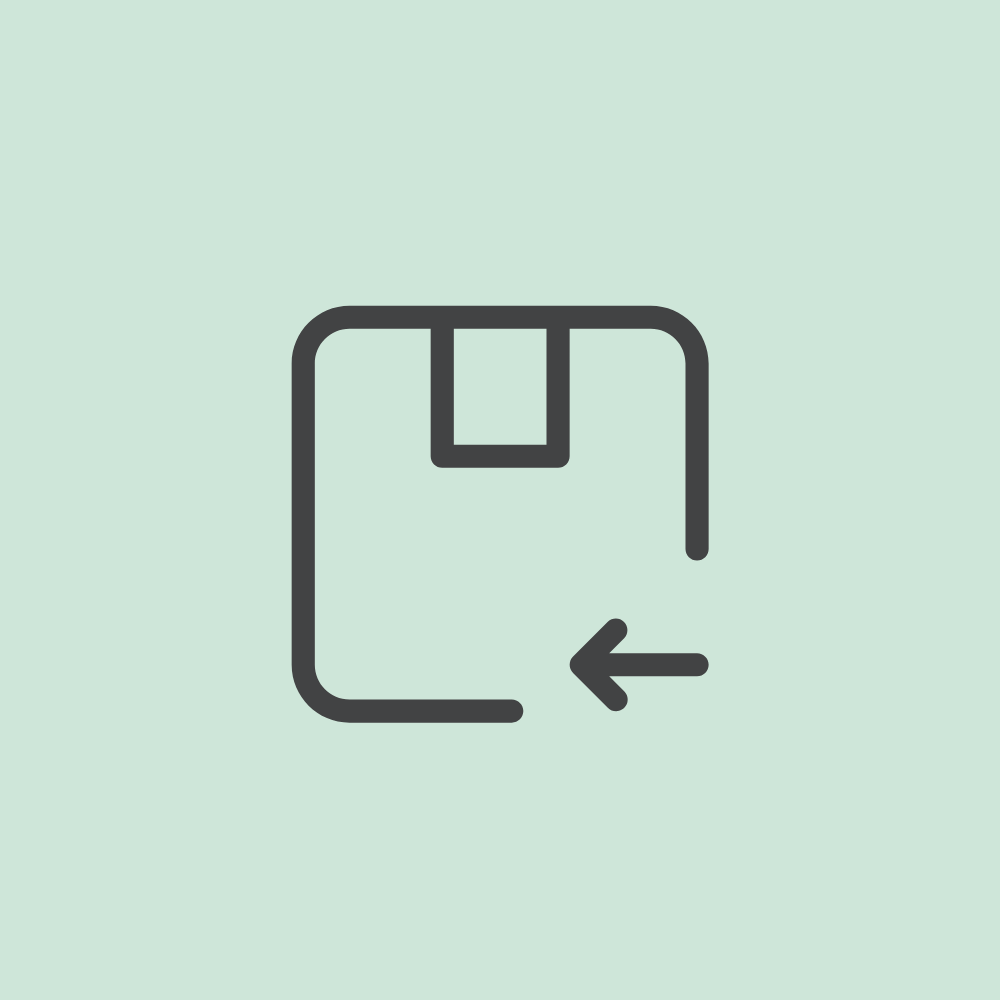Le savon. Ce petit objet glissant et moussant fait tellement partie de notre quotidien qu’on en oublierait presque qu’il a une histoire. Qui a inventé le savon ? À première vue, la question semble simple, mais la réponse nous entraîne dans un voyage à travers le temps, de l’Antiquité à nos salles de bain modernes. Préparez-vous à découvrir l’épopée du savon, racontée comme l’aventure d’un personnage à part entière – un héros humble mais indispensable de l’hygiène humaine, ayant traversé les siècles et conquis le monde.
Dans cet article, nous allons retracer la naissance du savon dans les civilisations anciennes, suivre son évolution au fil des époques, et révéler comment ce produit d’hygiène s’est transformé d’un luxe rare en un compagnon ordinaire de notre rituel de bain. Vous découvrirez des anecdotes surprenantes – des légendes romaines aux innovations des start-ups d’aujourd’hui – qui donnent vie à l’histoire du savon. Alors, plongeons sans plus attendre dans la saga pétillante de ce champion de la propreté !
Sommaire :
- Aux origines du savon : légendes et premières recettes
- Du Moyen Âge à la Renaissance : le savon entre oubli et tradition
- Le tournant industriel : du luxe à la nécessité (XVIIe – XIXe siècle)
- Le savon à l’époque contemporaine : rituel du bain et innovations
- Conclusion : l’héritage vivant du savon
Aux origines du savon : légendes et premières recettes
Il était une fois le savon, né bien avant que l’on puisse en attribuer l’invention à une seule personne. Pour remonter à ses origines, il faut imaginer nos lointains ancêtres expérimentant par hasard les effets nettoyants d’un mélange de cendres et de graisse. Une légende romaine raconte par exemple que le mot « savon » viendrait du mont Sapo : sur ce mont mythique, des animaux sacrifiés laissaient couler leur graisse qui se mêlait aux cendres des feux de sacrifice, formant une pâte savonneuse dans la rivière en contrebas. Les femmes auraient découvert que cette mixture lavait étonnamment bien le linge. Si cette histoire du mont Sapo est aujourd’hui considérée comme un mythe sans preuve concrète, elle illustre comment l’humanité s’est approprié très tôt la magie du savon.

En réalité, les premières traces connues de savon remontent à la plus haute Antiquité. Des tablettes d’argile sumériennes datées d’environ 2500 av. J.-C. mentionnent déjà une préparation à base d’huile et de cendres bouillies – une sorte de pâte qui servait à se laver ou à laver les tissus. Du côté de l’Égypte ancienne, le célèbre papyrus d’Ebers (vers 1550 av. J.-C.) décrit une formule mêlant huiles végétales et sels alcalins pour soigner les maladies de peau, ce qui ressemble fort à un ancêtre du savon. Autrement dit, personne ne peut se vanter d’être « l’inventeur » du savon : c’est une découverte collective, fruit de besoins pratiques et de hasards heureux dans plusieurs cultures.
Au fil des millénaires, chaque peuple a élaboré sa propre recette pour fabriquer du savon avec les ressources locales. Dans le monde antique, ce sont souvent les graisses animales ou les huiles végétales mélangées à des cendres végétales (riches en potasse) qui donnent naissance aux premiers savons bruts. Par exemple, les historiens pensent que le fameux savon d’Alep, originaire de Syrie, est l’un des plus vieux savons au monde. Fabriqué depuis environ 40 siècles, ce savon vert à base d’huile d’olive et d’huile de baies de laurier était séché à l’air libre et découpé en pains solides. Il illustre la sophistication qu’a pu atteindre l’art de la savonnerie dès l’Antiquité.
Mais qu’en est-il de l’invention du mot « savon » lui-même ? Pour cela, tournons-nous vers les Romains. L’encyclopdiste Pline l’Ancien, au 1er siècle apr. J.-C., évoque dans son Histoire naturelle un produit nommé sapo, « inventé chez les Gaulois ». Selon Pline, les Gaulois avaient mis au point une sorte de savon à partir de suif de chèvre (graisse animale) et de cendre de hêtre, qu’ils utilisaient non pas tant pour se laver le corps que pour teindre et embellir leurs cheveux en blond roux ! Il précise que ce « sapo » gaulois existait en deux formes : une version molle (pâte) et une version dure. Les peuples germains appréciaient également ce produit, les hommes l’utilisant même plus que les femmes pour se colorer la chevelure. Le terme latin sapo (d’où dérive notre mot « savon ») serait donc emprunté au vocabulaire gaulois. Ce détail montre que si les Babyloniens et les Égyptiens ont peut-être fabriqué les premiers savons artisanaux, les Gaulois, eux, ont donné son nom au savon en Occident.

Ainsi, bien avant de devenir le savon parfumé et normé que nous connaissons, le savon antique était déjà un héros discret de la propreté. Des rives de la Mésopotamie aux forêts gauloises, il a fait son apparition de manière indépendante en différents points du globe. Personne ne peut être couronné « inventeur du savon » à lui seul, car c’est l’expérience accumulée de générations d’apprentis chimistes anonymes qui a permis de percer le secret de la saponification (la réaction chimique entre un corps gras et une base alcaline). L’histoire du savon ne fait que commencer, et déjà, il traverse les civilisations…
Du Moyen Âge à la Renaissance : le savon entre oubli et tradition
Après la chute de l’Empire romain, l’usage du savon pour la toilette personnelle semble marquer le pas en Europe. Durant une bonne partie du Moyen Âge, se laver avec du savon n’était pas une habitude courante pour la plupart des gens. On privilégiait souvent l’eau pure (pour ceux qui prenaient encore des bains publics) ou on se contentait de parfumer son corps et ses vêtements avec des huiles aromatiques ou des herbes, afin de masquer les odeurs. Il faut dire qu’à certaines époques, une croyance répandue voulait que l’eau qui pénètre la peau puisse transmettre des maladies : on redoutait les « miasmes ». Le savon, lui, était considéré comme un produit de luxe, coûteux, que peu de personnes pouvaient s’offrir régulièrement.

Cependant, le savoir-faire de la savonnerie n’avait pas disparu partout. C’est dans le monde arabe que l’art du savon a été préservé et même perfectionné durant le Moyen Âge. Dès le VIIe siècle, on fabrique du savon de façon avancée au Moyen-Orient (on attribue par exemple aux artisans de la région d’Alep la recette traditionnelle évoquée plus haut). Les croisades, à partir du XIe siècle, vont jouer un rôle de passeur : les chevaliers et voyageurs occidentaux découvrent en Terre sainte des savons d’Orient aux qualités remarquables et rapportent ces secrets chez eux. C’est ainsi que la technique de fabrication du savon à base d’huile d’olive et de soude naturelle s’implante progressivement en Europe méditerranéenne.
À partir du XIIe et XIIIe siècles, des centres de production de savon émergent dans des villes comme Savone (en Italie, dont le nom aurait pu influencer le mot « savon »), Venise ou encore Alicante en Espagne musulmane. En ces lieux, souvent proches de salines (pour la soude) et de cultures d’oliviers (pour l’huile), on produit un savon dit « de Marseille » ou « d’Alicante » très prisé par les élites. Mais c’est sans doute la cité phocéenne de Marseille, en Provence, qui deviendra le berceau emblématique du savon en Occident. Dès le XVe siècle, Marseille compte plusieurs savonneries actives. Ce savon de Marseille originel, cuit en chaudrons à partir d’huile d’olive locale et de soude tirée des plantes de bord de mer, se présente sous la forme de gros blocs bruts, verts ou bruns, qu’on découpe et sèche.
Malgré cette production locale, jusqu’à la Renaissance, le savon reste un produit rare dans la vie quotidienne. Les rois et les nobles en achètent pour le linge fin ou pour offrir en cadeau, mais la plupart de la population européenne continue à s’en passer pour la toilette courante. Par exemple, on rapporte que la reine Élisabeth Ire d’Angleterre (au XVIe siècle) ne prenait qu’un bain par mois « qu’elle en ait besoin ou non » – illustrant l’exception que constituait encore le bain savonneux à cette époque ! En France, l’élite préfère souvent les parfums pour masquer les odeurs corporelles. Néanmoins, lentement mais sûrement, l’idée du savon fait son chemin. Les premières savonneries artisanales d’Europe posent les bases de ce qui deviendra bientôt une industrie florissante. Et c’est justement à l’époque moderne, du XVIIe au XIXe siècle, que le savon va passer de l’ombre à la lumière.
Le tournant industriel : du luxe à la nécessité (XVIIe – XIXe siècle)
Au XVIIe siècle, le savon entame son ascension en Europe, notamment en France. Un personnage inattendu joue alors un rôle clé dans son histoire : le roi Louis XIV, le Roi-Soleil. Par un édit célèbre promulgué en 1688 sous l’impulsion de son ministre Colbert, la fabrication du savon de Marseille est strictement réglementée dans tout le royaume. Cet édit impose que seul l’usage d’huile d’olive pure est autorisé dans les savonneries de Provence, bannissant les graisses de moindre qualité et autres abus. L’objectif est clair : garantir la qualité du savon français et empêcher les contrefaçons médiocres. Paradoxalement, à une époque où la Cour de Versailles est souvent moquée pour son hygiène douteuse (on disait que les nobles se parfumaient plus qu’ils ne se lavaient), le souverain français fait œuvre de précurseur en matière de normalisation du savon ! Grâce à cette mesure, le savon de Marseille gagne en réputation et en excellence.

Cette protection de la qualité arrive à point nommé car l’industrie du savon est en plein essor. À la fin du XVIIIe siècle, Marseille est devenue une véritable capitale de la savonnerie : en 1786, pas moins de 49 fabriques y produisent environ 76 000 tonnes de savon par an. Toutefois, ce produit demeure cher. Le savon est alors un produit artisanal dont la fabrication dépend d’ingrédients coûteux (huile d’olive, cendres de plantes) et de processus longs. Il reste un article semi-luxueux réservé en partie aux riches. La majorité du peuple, elle, continue souvent de se laver sans savon ou d’utiliser des solutions alternatives (comme les plantes à saponine, appelées « herbes à savon », pour faire mousser l’eau du bain).
C’est ici qu’entre en scène un autre grand homme de l’histoire française : Napoléon Bonaparte. Au tournant du XIXe siècle, en pleine Révolution industrielle, Napoléon et ses contemporains comprennent que pour démocratiser l’usage du savon, il faut le produire en grande quantité et à moindre coût. Or, un obstacle majeur limite la production : l’approvisionnement en soude (carbonate de sodium), un composant clé obtenu à partir de cendres végétales ou d’algues. La France, en guerre contre l’Angleterre, subit le blocus continental qui restreint l’importation de soude naturelle. Napoléon offre donc son soutien aux savants pour trouver une solution. C’est dans ce contexte qu’un chimiste français, Nicolas Leblanc, met au point en 1791 un procédé révolutionnaire pour fabriquer de la soude à partir de sel marin ordinaire. Cette découverte, connue sous le nom de « procédé Leblanc », va bouleverser l’industrie du savon : désormais, on peut disposer de grandes quantités de soude bon marché sans dépendre des cendres de plantes.
Armés de cette nouvelle matière première abondante, les savonniers du XIXe siècle peuvent faire passer le savon du statut de luxe à celui de produit de première nécessité. Parallèlement, les avancées de la chimie éclaircissent les mystères de la saponification. En 1823, le chimiste français Michel-Eugène Chevreul découvre la structure des corps gras et des acides gras, posant les bases scientifiques de la fabrication rationnelle du savon (c’est lui qui identifiera la glycérine comme sous-produit de la saponification). Grâce à de tels progrès, la qualité des savons devient plus constante, leur coût baisse et leur efficacité s’améliore.

Le XIXe siècle voit aussi un changement de mentalité radical vis-à-vis de l’hygiène. Les médecins hygiénistes et les découvertes de Pasteur sur les microbes incitent les populations à se laver régulièrement pour prévenir les maladies. Le savon, autrefois curiosité de chimistes et coquetterie de riches, devient une arme sanitaire. On commence à dire qu’une nation civilisée se reconnaît à la quantité de savon qu’elle utilise. C’est l’époque où naissent les grandes savonneries industrielles et les marques qui existent encore de nos jours. En Angleterre par exemple, la société Lever Brothers lance le Sunlight Soap à la fin des années 1880, un savon de lessive bon marché vendu en barres, tandis qu’aux États-Unis la fameuse barre Ivory (« flottante ») fait son apparition. En France, des savonniers comme Marseille et Toulon continuent d’inonder le marché de leurs savons durs à l’huile d’olive, et bientôt de nouvelles marques de savon de toilette voient le jour (telles que le savon de beauté Cadum au début du XXe siècle).
Ainsi, en l’espace de deux siècles, le savon a conquis tous les foyers. De produit artisanal coûteux, il est devenu un article manufacturé présent dans chaque salle de bain. Napoléon lui-même, s’il ne s’en doutait peut-être pas, a contribué à cette démocratisation en stimulant l’industrie chimique nécessaire à sa production. Le savon a gagné une guerre silencieuse contre la saleté : au sortir du XIXe siècle, il est désormais considéré comme indispensable à la santé publique, au même titre que l’eau potable.
Le savon à l’époque contemporaine : rituel du bain et innovations
Entrons maintenant dans nos salles de bain modernes. Le XXe et le début du XXIe siècle ont vu le triomphe du savon sous toutes ses formes, même si de nouveaux défis et de nouveaux concurrents sont apparus. Après la Seconde Guerre mondiale, les détergents synthétiques (issus de la pétrochimie) font leur apparition et concurrencent le savon traditionnel, notamment pour la lessive et les shampoings. C’est l’essor des gels douche, des savons liquides et autres produits moussants conditionnés en flacons colorés. Pendant un temps, la bonne vieille savonnette solide paraît un peu démodée face à ces nouveautés pratiques et parfumées à souhait. Mais le savon traditionnel n’a pas dit son dernier mot !
Aujourd’hui, le rituel du bain a retrouvé une dimension authentique et naturelle, et le savon en barre connaît un renouveau. De plus en plus de personnes redécouvrent le plaisir d’utiliser un savon artisanal aux ingrédients bio, sans emballage plastique, dans une démarche à la fois écologique et sensorielle. Prenons un instant pour imaginer la scène : l’eau chaude coule dans la baignoire, une douce vapeur emplit la pièce, et le parfum apaisant d’un savon à la lavande se diffuse. Vous savez qu’en sortant de ce bain relaxant, vous poserez les pieds sur un tapis de bain moelleux et qu’une serviette chaude vous attend. Ce moment de bien-être, nous le devons en grande partie au savon, ce compagnon fidèle qui transforme une simple douche en véritable moment de détente.

Le savon s’est même invité sur le terrain de l’innovation moderne. Ces dernières années, de nouvelles entreprises ont redonné ses lettres de noblesse à la savonnerie artisanale. Par exemple, deux ingénieurs français en quête de produits plus sains ont fondé en 2017 une savonnerie haut de gamme nommée Oppidum, renouant avec les techniques ancestrales pour créer des savons naturels exportés jusqu’en Asie. D’autres start-ups jouent la carte de l’écologie et de l’originalité : en 2024, une jeune entreprise lyonnaise a lancé une gamme de savons fabriqués à partir de légumes invendus récupérés sur les marchés ! Le concept peut faire sourire, mais il est brillant : transformer des carottes « moches » ou des brocolis invendus en savons exfoliants et vitaminés, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Qui aurait cru que cinq mille ans après sa création, le savon serait encore au cœur de l’innovation durable ?
Cet engouement pour les savons authentiques va de pair avec un retour aux recettes traditionnelles. Le savon de Marseille, par exemple, suscite à nouveau la passion des consommateurs en quête de naturel. Il connaît même des querelles dignes de son prestige : ces dernières années, une véritable « guerre du savon de Marseille » a éclaté entre différents fabricants. En effet, plusieurs associations de producteurs se sont disputé l’usage du nom « Savon de Marseille » et sa définition exacte. Doit-il être fabriqué uniquement dans la région de Marseille ? Doit-il contenir exclusivement de l’huile d’olive et aucune autre huile végétale ? Chacun défend âprement sa vision, au point que des actions en justice et des demandes d’Indication Géographique Protégée (IGP) ont vu le jour pour trancher la question. Preuve que même autour d’un cube de savon, les enjeux économiques et culturels peuvent être considérables !
Quoi qu’il en soit, dans nos maisons, le savon reste un élément central de la salle de bain. Posé près du lavabo sous forme liquide pour se laver les mains, ou solide sur son porte-savon à côté de la baignoire, il est de toutes les routines d’hygiène. Nos salles de bain modernes, avec leurs douches italiennes carrelées et leurs accessoires de confort comme les tapis de douche antidérapants, les tapis de bain antidérapants ou les colonnes de douche sophistiquées, offrent un cadre luxueux comparé aux bains rustiques d’antan. Mais malgré ces évolutions, le savon conserve son rôle fondamental et universel : nous nettoyer, nous protéger et nous apporter une sensation de fraîcheur et de bien-être au quotidien.
Conclusion : Qui a inventé le Savon ?
De la mystérieuse pâte grisâtre des Babyloniens au carré vert olive du savon de Marseille, du luxueux pain parfumé des nobles de la Renaissance au gel douche à la vanille de nos supermarchés, le savon a emprunté mille visages sans jamais disparaître. Plutôt que de chercher un seul inventeur au savon, il faut reconnaître que l’invention du savon est une œuvre collective de l’humanité. Chaque civilisation a apporté sa pierre (ou devrait-on dire sa bulle ?) à l’édifice, améliorant la recette et la diffusant un peu plus loin.

Qui a inventé le savon ? En un sens, nous tous – ou plutôt nos ancêtres de chaque époque. Le savon est le fruit de millénaires d’ingéniosité, de curiosité et d’échanges culturels. Et son histoire continue de s’écrire aujourd’hui dans nos salles de bain. La prochaine fois que vous frotterez vos mains avec un savon onctueux ou que vous savourerez la mousse soyeuse d’un bain moussant, pensez à tout ce chemin parcouru. Du fond d’un chaudron antique à votre étagère de salle de bain moderne, le savon n’a cessé de voyager et d’évoluer pour mieux nous servir.
En définitive, le véritable héros de cette histoire, ce n’est ni le marchand gaulois, ni le chimiste du roi, ni l’industriel moderne – c’est le savon lui-même, humble et indispensable. Il a su traverser les âges en s’adaptant à nos besoins, devenant à la fois symbole de propreté, instrument de santé publique et objet de plaisir sensoriel. Et si l’on devait tirer une morale de cette longue aventure, ce serait que même les choses les plus simples de notre quotidien, comme une barre de savon dans la douche, cachent souvent une histoire fascinante et un rôle bien plus grand qu’on ne l’imagine. Alors honorons ce vieux camarade de l’hygiène en lui reconnaissant sa juste valeur : le savon, une invention antique qui n’a jamais été aussi actuelle dans l’univers de la propreté et du bien-être.